Dans La Fille de l’Est, si l’on excepte le personnage principal – Ana Mladić, qui s’est réellement suicidée d’une balle dans la tête en 1994 – la plupart des personnages sont aujourd’hui détenus, inculpés de crimes contre l’humanité et prêts à tous les mensonges, à toutes les trahisons pour échapper à la prison à vie.
Clara Usón est romancière. Habituellement, elle invente des personnages mais pour écrire La Fille de l’Est, elle a repris la figure d’Ana Mladić, fille du général Ratko Mladić qu’en France, les envoyés spéciaux en Bosnie avaient baptisé le boucher des Balkans. Longtemps recherché en Serbie, commandant en chef de l’armée serbe de Bosnie qui bombardait Sarajevo et massacrait les musulmans de Srebrenica, c’est une des pires ordures que l’Europe ait vu naître depuis Hitler, Staline ou Franco. En faire le personnage central d’un roman, c’était une idée un peu monstrueuse, qui demanda trois ans de recherche pour aboutir à un livre complexe, où Mladić est d’abord un bon père de famille, juste un peu coléreux par moments, mais harassé par un travail difficile qui consistait à nettoyer la Bosnie Herzégovine de tous ses musulmans.

Un graffiti représentant Ratko Mladic, dessiné sur un mur de Belgrade le 29 mai 2011, au moment de son arrestation
« Son père était ce genre d’homme, capable de déplorer la mort d’un insecte. Sous son air austère et sa moralité inflexible, que certains prenaient pour de l’arrogance, se cachait un être timide au grand cœur. » (p. 165)
Et c’est d’abord la figure d’un héros qui s’édifie par les cinq cents pages du roman: « Personne ne se demandait ce qu’on pouvait faire pour que le pays s’en sorte, à l’exception de rares idéalistes comme son père, prêt à laisser sa peau, son sang, ses os, pour son peuple. » (p.168)
Adoré par sa fille, le général est raconté par Clara Usón à travers les yeux de ceux qui l’aiment, et c’est le plus troublant dans les premières pages du roman. Parce qu’en lisant, on se souvient aussi de ce vieil homme en costume gris, un peu perdu face à ses juges. Ce n’est qu’en mai 2011, après seize années de cavale, que la police serbe avait pris la peine d’arrêter et d’extrader Mladić aux Pays Bas, qu’il comparaisse enfin devant le Tribunal pénal international de La Haye.
Face à ses juges et à son procureur, Mladić doit répondre de onze chefs d’inculpation de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. L’instruction du procès est en cours, mais l’ancien chef d’Etat-major a déjà annoncé qu’il refusait de plaider coupable. Les audiences n’auront lieu que le matin pour que l’accusé, déjà victime de trois attaques cérébrales et à demi paralysé, puisse suivre le rythme d’un procès qui pourrait durer plusieurs années.
Le roman ne raconte rien du procès. Au présent, tandis qu’on lit ce livre paru en 2012 en Espagne, en France deux ans après, Mladić est devenu ce prisonnier malade et affaibli qui a gardé sa morgue, sa mauvaise foi et son mépris pour la justice. Portant casquette et costume gris, c’est un monstre en cage que filment les caméras des journalistes à sa première comparution, quand il annonce au juge qu’il plaidera non-coupable.
En avril 2015, Zdravko Tolimir, un général de l’armée serbe considéré comme le bras droit de Mladić, a vu sa condamnation à perpétuité confirmée en appel et c’est une bonne nouvelle pour les familles des victimes. Munira Subasic, présidente de l’association des Mères de Srebrenica et Zepa, s’est déclarée satisfaite, impatiente aussi d’apprendre le sort qui sera fait au général en chef.
Tout l’intérêt de La Fille de l’Est est dans cette distorsion. Ce personnage complexe et de plus en plus monstrueux que le roman dessine, nous connaissons son image au présent, celle d’une ordure venue jouer les justiciers au ban des accusés. Le verdict sera donné fin 2015, et la lecture du roman de Clara Usón en sera certainement à nouveau modifiée. Et c’est un mystère de la littérature, que cette capacité de métamorphoser un texte à partir d’une actualité qui continue de résonner à travers lui.
Au dernier chapitre du roman, l’un des personnages raconte une nouvelle de Danilo Kiš, Il est glorieux de mourir pour la patrie, parue en France dans L’Encyclopédie des morts. Le récit de Danilo Kiš se termine par des mots qui frappent, qui viennent aussi refermer le roman de Clara Usón : « L’histoire est écrite par les vainqueurs. Le peuple tisse les légendes. Les écrivains développent leur imagination. Seule la mort est indubitable. »
Hors-roman, Delila Lacevic tisse une autre légende après avoir fui la Bosnie, adoptée avec son frère par un couple du Kansas après la mort de ses parents. A 38 ans, elle n’est pas devenue un des personnages du livre mais elle a survécu aux massacres ordonnés par Mladić, qu’elle défie aujourd’hui à voix haute en utilisant la tribune du Los Angeles Times :
« Vous ne m’avez pas détruite. Vous ne m’avez pas tuée, même si vous avez essayé de le faire. Par le seul fait d’avoir survécu, j’ai gagné. »
Et j’avoue, c’est vrai, j’aurais voulu que Delila Lacevic puisse devenir, elle aussi, un personnage de La Fille de l’Est, que sa parole figure après les quatre phrases de Danilo Kiš pour terminer une nouvelle version du roman, écrite après la condamnation à vie de son principal personnage. Que le peuple puisse continuer de tisser ses légendes.
Arles, dans la maison d’Anne, mardi 22 septembre 2015
___________________
- La fille de l’Est de Clara Usón. Un entretien avec Clara Uson.
-
Bosnian victims await the war crimes trial of Ratko Mladic, Los Angeles Times, 15 mai 2012
-
TPIY : le procès de Ratko Mladic ajourné sine die, Le Monde, Aymeric Janier, 17 mai 2012
Clara Usón, livres parus en espagnol :
Las noches de San Juan, Lumen, 1998.
Primer vuelo, El Aleph, 2001
El viaje de las palabras, Plaza & Janes Editores, 2005
Perseguidoras, Alfaguara, 2006
Corazón de napalm, Seix Barral, 2010
La hija del Este, Seix Barral, 2012
Ouvrages de Clara Usón traduits en français :
Cœur de napalm, JC Lattès, 2012
La Fille de l’Est, Gallimard, 2014










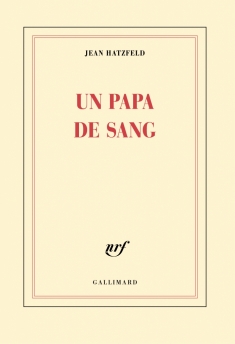


![IMG_6925[1]](https://uncahierrouge.org/wp-content/uploads/2013/09/img_69251.jpg?w=300&h=225)