
Je suis tsigane, Rajko Djuric
Rajko Đurić est un écrivain tsigane de Serbie. À Sarajevo, en fouillant dans l’ancienne bibliothèque du Centre André Malraux, je suis tombé sur un de ses textes, paru dans le numéro 1 des Carnets de Sarajevo, en 2001. Ces Carnets ont une histoire, liés aux premières Rencontres européennes du livre de Sarajevo, qui eurent lieu en septembre 2000 et 2001, à l’initiative du Centre André Malraux de Sarajevo, du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo et du Collège international des traducteurs d’Arles.
Le lien entre ces trois villes n’est pas sans importance. Et les Carnets sont passionnants à lire. Mais à ma connaissance, il n’y eut jamais de numéro 2.
Sans autorisation, je recopie ce texte de Rajko Đurić qui vaut la peine d’être diffusé et mémorisé. Que ses éditeurs me pardonnent, mais je sais que Rajko Đurić ne m’en voudra pas.
Je suis tsigane

Ceija Stojka, peinture, 2011
Je suis tsigane. Mon peuple et moi partageons la destinée d’Ulysse, qu’Homère a décrite il y a bien longtemps. Nous vivons dans le neuvième cercle de l’enfer, dont Dante Alighieri a donné une description pittoresque. Nous pendons encore sur la croix, à l’instar de Jésus autrefois, comme l’a exprimé le poète espagnol Antonio Machado, lui même rom.
Je suis tsigane. Mon peuple et moi pouvons comprendre ce que disent les cloches de vos églises, ainsi que l’a écrit dans un de ses poèmes Guillaume Apollinaire. Je sais rester fidèle à l’amitié même lorsque le cœur de mon peuple saigne comme l’a noté, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo à propos d’Esmaralda. Je m’efforce de demeurer humain en dépit du fait que l’inhumanité a un bel avenir devant elle, selon votre poète Paul Valéry qui s’est, en l’occurence, avéré prophète.
Je suis tsigane. Mon peuple et moi comprenons très bien le sens du mot «prophétique» dont Baudelaire a qualifié ma tribu. Vos ancêtres, vos rois, vos États ont déterminé le destin de mon peuple, l’obligeant à vivre sur vos décharges, à respirer l’air de vos geôles, à tester la solidité de vos potences et l’efficacité de vos guillotines.
Je suis tsigane. Votre peintre Delacroix a incarné mon peuple sur un de ses tableaux. Et en tant que Tsigane, j’entends fort bien le message de Jean-Paul Sartre, quand il dit que la vérité est toujours du côté des plus défavorisés et que les racistes et les antisémites sont des tueurs dans l’âme.
Je suis tsigane. Avec mon peuple et les Juifs, nos frères par l’histoire et la destinée, je n’oublierai jamais le poème de Paul Celan, Fugue de mort, et ses vers qui évoquent le «lait noir» qu’à Auschwitz on buvait le matin, à midi et la nuit.

Ceija Stojka, Ohne Titel, 42 x 29.5 cm
Je suis tsigane. Moi et mon peuple savons très bien ce que signifient la haine raciale, les persécutions et le génocide. Depuis l’arrivée de Hitler au pouvoir, nous avons connu trois holocaustes. Le premier, à l’époque du nazisme, le deuxième sous la dictature communiste — surtout en Russie sous Staline, en Roumanie sous Ceaucescu, et en Tchécoslovaquie avant Václav Havel —, et le troisième — je veux croire avec vous que ce sera le dernier — en ex-Yougoslavie, pendant les guerres de Bosnie et du Kosovo. Des 300 000 Roms qui vivaient en Bosnie, il n’en reste que 15 000 et leur nombre est au Kosovo passé de 264 000 à 8 600 !
Je suis tsigane. Depuis le XIIIe siècle, mon peuple a démontré ce que pourrait être une Europe sans frontières. Il le paie encore aujourd’hui, jour et nuit, de sa souffrance, de son sang et parfois de sa vie. L’Europe sans frontières que l’on veut instituer ne saurait être uniquement celle des plus puissants, à savoir des Allemands et des Français, elle ne doit pas se transformer en un nouvel État. Cette Europe sans frontières ne peut avoir de sens que si elle devient une vaste communauté de peuples et de citoyens libres et égaux.

Ceija Stojka, Die Peitsche knallt von Frau Pinz, 34.5 x 42 cm
Je sais que pour le moment il ne me sert à rien d’en être conscient. Car depuis des siècles en Europe, les grandes vérités ont été énoncées dans les geôles ou sur le bûcher. Certes, Hitler est mort. Mais son ombre, tel le spectre du Hamlet de Shakespeare, hante toujours certains pays européens. Elle s’est incarnée en quelques-uns de leurs dirigeants — Slobodan Milošević en Serbie, Franjo Tudjman en Croatie, Heider en Autriche — et même en quelques hommes politiques allemands (d’aucuns ont brigué la Chancellerie)/ Elle va et vient de la Russie au sud de la France, en passant par les pays baltes et l’Italie.
Les hommes d’aujourd’hui, perdus dans la masse, sont «anesthésiés». À la différence des contemporains d’Auschwitz qui, comme l’a montré le film Shoah, prétendaient ne pas savoir ce qui se passait derrière les barbelés, ce qu’on brûlait dans les chambres à gaz, ils essaient de se dédouaner par la sacro-sainte formule : «Je ne comprends pas.»
Je suis tsigane. C’est pourquoi je me permets d’évoquer devant vous l’expérience de mon peuple. Pensez et agissez de façon à ce que l’inhumanité ait le moins d’avenir possible en Europe. (Le prix Nobel Günter Grass et l’écrivain italien Antonio Tabucchi sont aujourd’hui les premiers à élever la voix contre l’injustice que subissent les Roms en Europe. Leurs paroles sont un baume sur les plaies de mon peuple.)
En tant que Tsigane, je vous le dis : vous aurez beau être un grand écrivain, un brillant journaliste ou un bon politicien, si vous faites taire votre conscience, si vous ne dites pas non à l’injustice et au mal qui pèsent plus particulièrement sur ce peuple de douze millions d’habitants, vous n’aurez pas contribué suffisamment à rendre l’Europe et le monde plus humains.
Traduit du serbo-croate par Mireille Robin.
Les peintures qui illustrent le texte de Rajko Đurić sont de Ceija Stojka, peintre tsigane d’Autriche qui a connu les camps nazis dans son enfance, où elle a perdu une grande partie de sa famille.
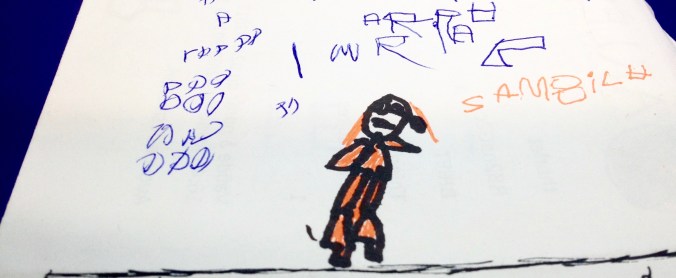
 corruption est devenue une plaie impossible à soigner. Le jour où des ministres ont voulu faire passer une loi pour amnistier les élus corrompus, les familles roumaines sont descendues par centaines de millers dans les rues pour demander leur démission. Le roman de Fanny Chartres parle précisément de cette maladie sociale, et des ravages qu’elle ne cesse pas de provoquer à l’intérieur des hôpitaux et administrations.
corruption est devenue une plaie impossible à soigner. Le jour où des ministres ont voulu faire passer une loi pour amnistier les élus corrompus, les familles roumaines sont descendues par centaines de millers dans les rues pour demander leur démission. Le roman de Fanny Chartres parle précisément de cette maladie sociale, et des ravages qu’elle ne cesse pas de provoquer à l’intérieur des hôpitaux et administrations. En réalité, les fraises sont une chimère : le père des deux jeunes sœurs est un médecin tout juste diplômé qui s’est résolu à s’exiler en France pour y être opéré d’un cancer. En Roumanie, la corruption a fait des hôpitaux des lieux dangereux, où faute d’argent au noir pour se payer l’attention des infirmières et des médecins, on peut vous laisser mourir sans rien tenter. La moindre opération chirurgicale peut vous coûter toutes vos économies en dessous de table, si vous avez la chance d’en avoir suffisamment, et nombre de familles y ont laissé des fortunes pour essayer de sauver un parent.
En réalité, les fraises sont une chimère : le père des deux jeunes sœurs est un médecin tout juste diplômé qui s’est résolu à s’exiler en France pour y être opéré d’un cancer. En Roumanie, la corruption a fait des hôpitaux des lieux dangereux, où faute d’argent au noir pour se payer l’attention des infirmières et des médecins, on peut vous laisser mourir sans rien tenter. La moindre opération chirurgicale peut vous coûter toutes vos économies en dessous de table, si vous avez la chance d’en avoir suffisamment, et nombre de familles y ont laissé des fortunes pour essayer de sauver un parent.




