
Ilya Ehrenbourg devant son portrait par Pablo Picasso
À Michel Parfenov
Dans les Mémoires d’Ylia Ehrenbourg, Les Gens, les années, la vie, on trouve un beau portrait de Peretz Markish, au beau milieu du Livre trois, qui concerne les années 1921-1933 et fut rédigé durant l’hiver 1961. Ehrenbourg et Markish s’étaient connus à Kiev, revus à Paris puis à Moscou, où ils avaient pris part, avec Vassili Grossman, au Comité antifasciste juif et à la rédaction du Livre noir sur l’extermination scélérate des juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l’URSS et dans les camps d’extermination en Pologne pendant la guerre 1941-1945.
Ilya Grigorievitch Ehrenbourg est né à Kiev, le 27 janvier 1891. C’est à Paris, à partir de 1908, qu’il fréquente les révolutionnaires russes émigrés en partageant la vie d’artistes comme Picasso, Apollinaire ou Francis James. Il y devient journaliste et revient en Russie après la révolution de février 1917, en passant par Kiev et le Caucase. C’est en 1921 qu’il revient à Paris, comme correspondant de la presse soviétique. Il sera l’un des artisans du Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui se réunit à Paris en 1935, et couvrira pour les Izvestia la Guerre d’Espagne, aux côtés de Hemingway. Il regagne l’URSS en 1940 pour devenir correspondant de guerre dès 1941, aux côtés de Vassili Grossman. Il obtient deux fois le prix Staline pour ses romans, en 1942 et 1947, et échappe aux persécutions antisémites qui toucheront Peretz Markish et la plupart des autres écrivains du Comité antifasciste juif.

Esther Markish, l’épouse de Peretz
Dans sa préface aux Mémoires, Michel Parfenov précise qu’Esther Markish, la veuve de Peretz, a reproché à Ylia Ehrenbourg de n’avoir rien tenté pour sauver son mari : «Ehrenbourg, bon gré mal gré, à demi-mot, a presque reconnu son rôle de « paravent » et avoué sa lâcheté… Il commence par un mensonge évident : en 1949, à ce qu’il dit, il ne comprenait rien, Staline savait masquer beaucoup de choses. Et pourtant, qu’y avait-il d’incompréhensible pour Ehrenbourg qui avait tant vu et eu tant d’expériences dans sa vie, quand une odeur de sang juif flottait déjà dans l’air et que, par la dimension des répressions, le pays avait déjà dépassé le seuil des années 1936-1938.»

Peretz Markish à Moscou, en 1945
Voici donc les quatre pages qu’Ylia Ehrenbourg a consacrées à la mémoire de Peretz Markish, neuf ans après l’exécution du poète dans les caves de la Loubianka :
« En passant devant La Rotonde, je vis à la terrasse un visage connu. C’était le poète Peretz Markish que j’avais connu à Vienne. Il était difficile de ne pas le remarquer, car son beau visage inspiré se détachait dans n’importe quel environnement. Boris Lavrenev assurait que Markish ressemblait à Byron. Peut-être, mais peut-être ressemblait-il seulement à cette image du poète romantique qui ressort de centaines de toiles ou de dessins, de poèmes, de l’air d’une autre époque. Markish n’était pas seulement romantique dans sa poésie. Ses cheveux bouclaient de façon romantique, son port de tête était romantique (il ne portait pas de cravate et son col était toujours ouvert). Et cet air adolescent, qu’il conserva jusqu’à la mort, était lui aussi romantique.

Oyzer Warszawski, Memorial Book of Sochaczew, p. 257
Il y avait à la même table que lui un écrivain juif polonais, Warszawski, et un peintre dont j’ai oublié le nom. Je connaissais Warszawski par son roman, Les Contrebandiers, qui avait été traduit en plusieurs langues. Il était timide et parlait peu. Le peintre, au contraire, parlait sans arrêt des expositions, des critiques, de la difficulté de vivre à Paris. Il était bessarabien et était arrivé depuis peu de temps à Paris, il travaillait comme peintre en bâtiment, et peignait des paysages à ses heures de loisir. Je ne sais plus si c’est Waszarwski ou le peintre qui a raconté l’histoire du pipeau. C’était une légende hassidique (les hassidim étaient une secte mystique qui s’était soulevée au XVIIIe siècle contre les rabbins et les riches hypocrites). Je me suis souvenu de cette légende et l’ai incluse par la suite dans mon roman La Vie tumultueuse de Lazik Roitschwanets. Ce livre est peu connu, et je vais raconter cette histoire.

Portrait d’Ylia Ehrenbourg par Henri Matiise, 1946
Dans un shetl de Volhynie, il y avait un célèbre zadik, c’est-à-dire un juste. Dans ce shetl, comme partout, il y avait des riches qui prêtaient de l’argent à intérêts, des propriétaires, des marchands, , il y avait des gens qui rêvaient de s’enrichir par n’importe quel moyen. En bref, il y avait beaucoup de mécréants. C’était le jour du Grand Pardon où, selon les croyances des Juifs religieux, Dieu juge les hommes et décide de leur destin. Ce jour-là, ils ne boivent ni ne mangent jusqu’à ce que se lève l’étoile du soir et que les rabbins les laissent partir de la synagogue. Le zadik priait Dieu de pardonner aux hommes leurs péchés, mais Dieu faisait la sourde oreille. Soudain, un pipeau brisa le silence. Parmi les pauvres qui se tenaient au fond, il y avait un tailleur avec son petit garçon de cinq ans. Le gamin était las des prières, et il se rappela qu’il avait dans sa poche un pipeau à un sou que son père lui avait acheté la veille. Tout le monde se jeta sur le tailleur. C’était à cause de bêtises comme ça que le Seigneur châtiait le shetl. Mais le zadik vit que le Dieu vengeur n’avait pu s’empêcher de sourire.

Vladimir Maïakovski
Voilà toute la légende. Elle avait ému Markish, et il s’était écrié : «Mais c’est de l’art qu’il est question !» Ensuite, nous nous sommes levés et avons regagné nos pénates. Markish m’accompagna jusqu’au coin, et soudains (nous parlions de tout autre chose), il dit : «À présent, un pipeau ne suffit pas, il faut la trompette de Maïakovski…»
Il me semble que cette phrase explique qu’il ait connu tant d’années difficiles. Il n’était pas fait pour les slogans bruyants, ni pour les poèmes épiques, c’était un poète avec un pipeau qui émettait des sons purs et perçants. Mais il n’y avait pas eu de Dieu inventé capable de sourire, et le siècle était bruyant, et les oreilles des gens, parfois, ne distinguaient pas la musique.
Il y a toujours eu beaucoup de versificateurs, et ils se sont multipliés lorsque la production de vers est devenue un métier. Markish, lui, était un poète. Il est évidemment difficile de juger de poésie en traduction, et je ne connais pas le yiddish, mais à chaque fois que je lui ai parlé, j’ai été frappé par sa nature. Il interprétait les grands événements et les détails de la vie en poète. Ce n’est pas seulement ma propre impression, des gens très différents les uns des autres me l’ont dit aussi, Alexis Tolstoï, Tuwim, Jean-Richard Bloch, Zabolotski, Nezval.
Il n’avait pas peur des sujets ressassés, il parlait souvent de ce dont avaient parlé tous les poètes du monde. La forêt en automne :
Les feuilles ne bruissent pas dans une mystérieuse angoisse
Mais, recroquevillées, gisent et sommeillent au vent.
Soudain en voilà une qui, réveillée, s’en est allée sur la route
Chercher sa tanière, semblable à une souris dorée.
Une larme de la bien-aimée :
Elle ne tombe pas de tes cils,
Mais demeure, tremblante, entre tes paupières,
En elle le monde quitte ses frontières,
Et dans les profondeurs, la pupille brillante s’élargit.
C’était un maître, et il travaillait sans cesse. On peut dire de lui ce qu’il disait d’un vieux tailleur :
Que pouvait-il encore apporter ici,
À ces villages reculés ?
Des années piquées,
Une aiguille poussée.

Portrait de Peretz Markish par Marc Chagall, 1923
Markish ne se détournait pas de la vie. Il n’acceptait pas seulement son époque, il l’aimait passionnément. Il écrivait des poèmes épiques sur la construction, sur la guerre. C’était un homme extraordinairement pur, et il protégeait jalousement ce qu’il aimait de l’ombre du doute. Il était soviétique de la tête aux pieds et, bien que nous appartenions à la même génération (il avait quatre ans de moins que moi), je m’émerveillais de son caractère entier. Il avait vu des pogroms, il avait vécu en Pologne en pleine montée de l’antisémitisme, mais il n’y avait pas en lui une ombre de nationalisme, même pas celui de la souris qui sait que les chats s’étirent sur le plancher au-dessus d’elle. S’il faut donner un exemple d’internationalisme, on peut sans crainte le citer.
Les critiques ont noté que l’on sentait parfois dans ses œuvres de la tristesse, de l’amertume, de l’angoisse. Pouvait-il en être autrement ? L’un de ses premiers poèmes, «Le Tas», est consacré au pogrom de Gorodichtché. J’ai lu récemment une traduction d’un roman inédit qu’il a achevé peu de temps avant d’être tué, c’est une chronique des souffrances, de la lutte et de l’anéantissement du ghetto de Varsovie.
Mais je ne veux pas me limiter à la référence à l’époque. Il faut aussi parler de la structure du poète. Je citerai un dialogue qui a eu lieu il y a très longtemps entre deux poètes espagnols, Rabbi Shem Tov et le marquis de Santillane. Les Juifs et les Arabes ont introduit dans la poésie espagnole les vers gnomiques, de brèves sentences philosophiques. L’un de ces poètes était Rabbi Shem Tov. Le roi Pierre-le-Cruel, qui souffrait d’insomnie, lui avait commandé des vers. Le poète avait appelé son livre Conseils, et il commençait par la consolation suivante :
Il n’est rien au monde
Qui croisse sans cesse.
Lorsque la lune est pleine
Elle commence à décroître.
Bien des décennies plus tard, un poète de cour, le marquis de Santillane, écrivit l’épigramme suivante :
De même que le bon vin est parfois gardé
dans un mauvais tonneau
La vérité sort parfois de la bouche des Juifs.
Rabbi Shem Tov semble prophétiser :
Lorsque le monde a été créé,
Le monde a été partagé :
Les uns ont eu le bon vin
Et les autres la soif.
Markish n’appartenait pas aux poètes du bon vin, mais à ceux aux lèvres sèches. De là cette teinture à peine perceptible d’amertume qui apparaît parfois dans ses vers pleins de joie de vivre.
Je le voyais rarement. Nous vivions dans des mondes différents, mais chaque fois que je rencontrais Markish, je sentais que j’avais devant moi un homme merveilleux, un poète et un révolutionnaire, qui n’offenserait jamais personne, ne trahirait pas ses amis, ne se détournerait pas de de ceux auxquels un malheur était arrivé.

Peretz Markish lisant son appel, en août 1941, au sein du Comité juif antifasciste
Je me souviens d’un meeting qui avait eu lieu à Moscou en août 1941, et qui avait été retransmis par la radio en Amérique. À ce meeting avaient pris la parole Peretz Markish, Sergueï Eisenstein, Salomon Mikhoëls (1), Piotr Kapitsa (2) et moi. Markish avait lancé un appel passionné aux Juifs américains pour qu’ils exigent que les Etats-Unis combattent le fascisme (l’Amérique était encore neutre à cette époque).
Je vis Markish pour la dernière fois le 23 janvier 1949 à l’Union des écrivains, aux obsèques du poète Mikhaïl Golodny. Markish me serra la main avec tristesse. Nous nous regardâmes longuement, essayant de deviner qui tirerait le mauvais numéro.
Peretz Markish fut arrêté quatre jours plus tard, le 27 janvier 1949, et il est mort le 12 août 1952 (3).
Comme tous les gens qui ont rencontré Markish, je pense à lui avec une tendresse presque superstitieuse. Je me souviens de ses vers :
Deux oiseaux morts tombèrent à terre
Le coup était réussi. Qu’y a-t-il de mieux que la terre ?
Ici, dans ce pays ensoleillé et béni,
Il faut tomber, si c’est le destin ! C’est ce qu’il me semble…
Je me mis en route, allons-y, tu entends, allons-y !
Bon, il est tombé. Ne regrette rien,
Il faut voler, si c’est le destin. Comme la lumière est éblouissante !
Les étendues sont vastes, elles n’ont pas de fin.
Il est difficile de se faire à l’idée qu’on a tué un poète.
Mais dans ces jours lointains où j’ai rencontré Markish, jeune et inspiré, à Montparnasse, il parlait du pipeau d’un enfant et de la voix de tonnerre de Maïakovski, il mesurait son destin. Pour moi, il était la preuve que l’on ne peut pas séparer une époque de sa poésie :
Je t’ai hissé sur mes épaules,
Ô siècle !
Je t’ai mis, en guise de ceinture,
Une larde ceinture de pierre.
La route monte en un énorme escarpement,
Et je dois l’escalader.
À travers les hurlements du vent, les tourbillons de neige
Je monte… Beaucoup périssent
Au milieu des congères…
Non, il n’était pas un naïf rêveur ni un fanatique aveugle, le pipeau touchait les lèvres sèches d’un homme adulte et courageux.»
______________
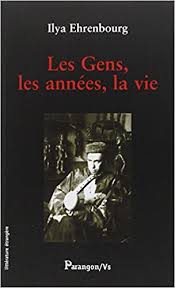
Ilya Ehrenbourg, Les Gens, les années, la vie
Ilya Ehrenbourg, Les Gens, les années, la vie, Lyon, Parangon/Vs, 2008, traduit du russe par Michèle Kahn, préface de Michel Parfenov, pages 494 à 498.
________________________
(1) Salomon Mikhoëls (1890-1948), acteur et metteur en scène, directeur du théâtre juif de Moscou, président du Comité antifasciste juif, assassiné sur ordre de Staline en 1948.
(2) Piotr Kapitsa (1894-1984), physicien soviétique, lauréat du prix Nobel en 1978.
(3) Ce jour-là, Markish fut fusillé en compagnie d’autres personnalités éminentes de la culture juive, parmi lesquelles I. Kitko, D. Bergelson, D. Hofestein.







 Je savais qu’en commençant à lire Si c’est un homme, j’allais être ébranlé par ce récit que Primo Levi avait ramené de l’enfer. Et j’avais sûrement raison d’avoir un peu peur. Et peur depuis longtemps. Le regard de Levi sur l’expérience du Lager commence par un poème qui est avant tout une mise en garde. Gravez ces mots dans votre cœur. Si c’est un homme qui meurt pour un oui pour un non. N’oubliez pas que cela fut. Si c’est une femme, les yeux vides et le sein froid. Pensez-y chez vous, dans la rue. Sinon votre maison s’écroulera. Sinon la maladie vous prendra. Et les mots qu’il faut graver dans sa mémoire sont sans appel. En 1944, les maîtres d’Auschwitz étaient nazi
Je savais qu’en commençant à lire Si c’est un homme, j’allais être ébranlé par ce récit que Primo Levi avait ramené de l’enfer. Et j’avais sûrement raison d’avoir un peu peur. Et peur depuis longtemps. Le regard de Levi sur l’expérience du Lager commence par un poème qui est avant tout une mise en garde. Gravez ces mots dans votre cœur. Si c’est un homme qui meurt pour un oui pour un non. N’oubliez pas que cela fut. Si c’est une femme, les yeux vides et le sein froid. Pensez-y chez vous, dans la rue. Sinon votre maison s’écroulera. Sinon la maladie vous prendra. Et les mots qu’il faut graver dans sa mémoire sont sans appel. En 1944, les maîtres d’Auschwitz étaient nazi

 les noms des dirigeants et des maîtres du désastre sont partout, ceux des noyés se sont perdus dans les profondeurs d’une mer endeuillée. Dans Si c’est un homme, Primo Levi tente le geste inverse et ramène à nos mémoires le nom de Resnyk, un prisonnier polonais de trente ans dont il partage le lit, à l’intérieur du Block 45 : « Il m’a raconté son histoire, et aujourd’hui je l’ai oubliée, mais c’était à coup sûr une histoire douloureuse, cruelle et touchante, comme le sont toutes nos histoires, des centaines de milliers d’histoires toutes différentes et toutes pleines d’une étonnante et tragique nécessité. Le soir, nous nous les racontons entre nous : elles se sont déroulées en Norvège, en Italie, en Algérie, en Ukraine, et elles sont simples et incompréhensibles comme les histoires de la Bible. Mais ne sont-elles pas à leur tour les histoires d’une nouvelle Bible ?»
les noms des dirigeants et des maîtres du désastre sont partout, ceux des noyés se sont perdus dans les profondeurs d’une mer endeuillée. Dans Si c’est un homme, Primo Levi tente le geste inverse et ramène à nos mémoires le nom de Resnyk, un prisonnier polonais de trente ans dont il partage le lit, à l’intérieur du Block 45 : « Il m’a raconté son histoire, et aujourd’hui je l’ai oubliée, mais c’était à coup sûr une histoire douloureuse, cruelle et touchante, comme le sont toutes nos histoires, des centaines de milliers d’histoires toutes différentes et toutes pleines d’une étonnante et tragique nécessité. Le soir, nous nous les racontons entre nous : elles se sont déroulées en Norvège, en Italie, en Algérie, en Ukraine, et elles sont simples et incompréhensibles comme les histoires de la Bible. Mais ne sont-elles pas à leur tour les histoires d’une nouvelle Bible ?»