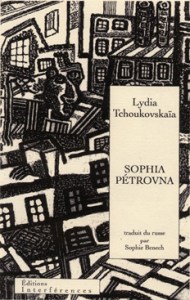Isidore Glikine et sa fille, Tatyana
Isidore Glikine n’est pas seulement le personnage d’un livre un peu ancien, venu des profondeurs d’un pays maintenant disparu, l’URSS des années sombres. Simple figurant plutôt qu’un personnage, une apparition de quelques lignes à peine dans un ouvrage de plus de cinq cent pages, un livre d’entretiens avec Anna Akhmatova, écrit par Lydia Tchoukovskaïa de 1938 à 1962, toutes ces années d’amitié où ensemble, elles affrontèrent la censure et une surveillance policière incessante. Isidore Glikine a existé, ingénieur à Leningrad, il a protégé un livre impossible à publier du vivant de Staline, il a eu une petite fille qui s’appelait Tatyana et a accompli cet exploit d’abriter le manuscrit d’une dissidente, écrit par une amie qui lui rendra hommage à l’intérieur d’un autre livre.
Page 493 des Entretiens avec Anna Akhmatova, les deux femmes parlent de Soljenitsyne puis de Sofia Petrovna, un roman écrit par Lydia Tchoukovskaïa en 1939, traduit en français en 1975 alors qu’il circulait depuis presque vingt ans sous forme de samizdat en Russie.
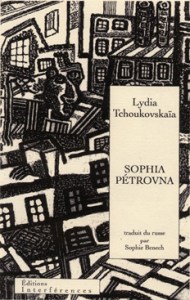
La couverture de Sophia Petrovna, paru en 2007 aux éditions Interférences, dans une traduction de Sophie Benech
Dans le livre des entretiens, c’est Anna Akhmatova qui aborde le sujet la première, s’adressant à Lydia Tchoukovskaïa : « – Je n’ai pas le courage de relire Sofia Petrovna, de me replonger dans cette époque maudite. Maria Petrovykh m’a dit exactement la même chose. Vous avez accompli un exploit. Si, si. Ne niez pas. Nous pensions tous la même chose, nous écrivions des poèmes, nous les gardions dans nos mémoires, ou nous les inscrivions pour un instant, brûlant le papier presque aussitôt, mais vous, vous avez écrit un livre. Sachant ce qui pourrait vous arriver, à vous et à votre fille. Vous l’avez écrit sous la menace du couperet.
Je ne nie rien, je ne cherche pas à discuter, je me sens confuse et fière, mais j’essaie d’expliquer mon acte, tel que je le revois dans mon souvenir. Il m’était impossible de ne pas écrire ce que j’avais écrit. Il aurait été plus pénible et plus affreux de ne pas écrire. Ecrire était un soulagement. Cela m’était nécessaire. Je le faisais pour moi, pas pour les autres. Je couchais tout par écrit, parce qu’ainsi je comprenais mieux ce que je décrivais. C’était peut-être même la seule façon de comprendre. Je voulais à tout prix découvrir pourquoi notre société était inconsciente et aveugle, pourquoi je voyais, moi, des choses que les autres n’apercevaient pas. Cette inconscience de toute une société, je lui donnais le nom très ordinaire de Sofia Petrovna, dont l’aveuglement était celui de millions de gens. Je ne trouvais pas, à l’époque, qu’écrire fût un exploit. Ecrire était aussi naturel que respirer ou se laver. »

Première édition en russe des Entretiens avec Anna Akhmatova, YMCA Press, Paris
C’est à ce moment-là que Tchoukovskaïa évoque le courage de son ami Glikine, celui qui a sauvé son livre à deux reprises : « C’est Isidore Glikine qui a accompli un exploit en acceptant de garder mon manuscrit à un moment pareil. Je partais pour Moscou, avec Lioucha, me faire opérer. Garder un manuscrit, ça c’était l’exploit par excellence. Pendant le siège de Leningrad, Glikine est mort de faim et dans l’épuisement de l’agonie, il a traversé la ville entière pour confier mon manuscrit à sa sœur : un autre exploit. »
J’ai cherché à savoir qui était Isidore Glikine. Исидор Гликин, si on écrit son nom en cyrillique. Je n’ai trouvé qu’une seule photo de son visage, avec sa fille encore bébé qu’il montre au photographe. J’ai appris qu’il était né à Sumy, en Ukraine, la même année que Lydia Tchoukovskaïa, en 1907. Il était devenu ingénieur en électromécanique à Leningrad, après avoir étudié à l’Institut d’Histoire de l’art puis à l’Institut Polytechnique. Il habitait au 5, rue Sovetskaya et souffrait, au début de la guerre, d’une forme aigüe de scarlatine qui lui évita d’être envoyé sur le front. Se sachant condamné par les médecins, il confia le manuscrit de Sophia Petrovna à sa sœur, deux jours avant sa mort, le 22 janvier 1942.
Soljenitsyne évoque lui aussi la figure de Glikine dans L’Archipel du Goulag. « En ces temps terribles, écrit-il, quand dans les affres de la solitude on brûlait les journaux intimes, les photos et les lettres les plus chères, quand chaque papier jauni dans l’armoire familiale se déployait soudain en une flamboyante fougère de mort et ne demandait qu’à se jeter de lui-même dans le poêle, quel courage ne fallait-il pas pour conserver, pour ne pas brûler durant des milliers et des milliers de nuits les manuscrits d’un condamné (comme Florenski) ou d’un réprouvé notoire (comme le philosophe Fiodorov) ! Comme devait apparaître comme anti-soviétique, clandestin, dangereusement subversif le récit de Lidia Tchoukovskaïa, Sofia Petrovna ! Il fut conservé par Isidore Glikine. Dans Leningrad assiégé, pressentant sa mort, il se traîna à travers toute la ville pour le remettre à sa sœur, et le récit fut sauvé. »

Alexandre Soljenitsyne en 1974
Soljenitsyne développera à son tour des techniques de plus en plus complexes pour préserver ses manuscrits. Pour lui, l’histoire d’Isidore Glikine est d’autant plus frappante qu’Élisabeth Voronianskaïa, l’une de ses complices qui avait dactylographié le manuscrit de L’Archipel du Goulag, se suicidera après avoir avoué sous la torture où se cachait le tapuscrit tant recherché, qu’elle avait enterré au fond de son jardin. Soljenitsyne s’en voudra longtemps, car son amie ignorait qu’il existait d’autres copies, cachées chez d’autres complices. En 1973, en apprenant la pendaison d’Élisabeth Voronianskaïa, il se décide à divulguer la nouvelle et à faire publier l’Archipel du Goulag à Paris.

Lydia Tchoukovskaïa,
J’ai cherché à savoir qui était la sœur d’Isidore Glikine, qui continua de cacher le manuscrit de Lydia Tchoukovskaïa après la guerre, pendant plus d’une dizaine d’années. Par fidélité à son frère, j’imagine. J’ignore encore si elle connaissait l’auteur du texte, mais j’ai appris qu’elle s’appelait Rosalia Glikina, et qu’elle vécut à Leningrad jusqu’au milieu des années cinquante. Quand Lydia Tchoukovskaïa apprit la mort de Rosalia, en 1956, elle prit le train de Moscou à Leningrad, et se présenta à son appartement, boulevard des syndicats. Les nouveaux occupants lui indiquèrent un tas de paperasses qui prenaient la poussière au fond d’un réduit. C’est là qu’elle retrouva le manuscrit de Sophia Petrovna, qu’elle n’osa pas relire dans le train du retour, et qu’elle dissimula encore plusieurs mois avant qu’il ne paraisse en samizdat, en 1957.
« Je ne voulais qu’une seule chose, a écrit Lydia Tchoukovskaïa dans la postface de Sophia Petrovna, c’était de voir mon livre publié en Union soviétique. Dans mon propre pays. Dans le pays de Sophia Petrovna. J’ai attendu patiemment pendant trente-quatre ans. »
En 1987, elle refuse la publication des Entretiens avec Anna Akhmatova tant que
Sophia Petrovna n’a pas le droit d’être publié.
______________________
Sofia Petrovna, de Lydia Tchoukovskaïa, a d’abord paru en 1975 aux éditions Calman-Lévy, sous le titre La Maison déserte.
En 2003, une nouvelle édition traduite du russe par Sophie Benech a paru aux éditions Interférences.
Il existe une étude intéressante de Sofia Petrovna en anglais :
A Path of Healing and Resistance : Lydia Chukovskaya’s Sofia Petrovna and Going Under, Amber Marie Aragon, Washington University in St. Louis

 midi est venue cette idée, d’une discussion avec Ricardo. Une idée simple, de lancer un appel à lire les textes d’Asli Erdoğan partout où on ne l’attendait pas. Dans les théâtres, les rues, les rencontres d’écrivains, les festivals, les Nuit Debout, les radios, les ateliers d’artistes, les librairies. Je fais confiance à Ricardo. Son théâtre est un lieu de parole, une scène où la parole peut s’inventer enfin libre, coléreuse, imprévue. Et puis il avait lutté contre la junte de Pinochet, au Chili, en utilisant la subversion d’un théâtre de rue impossible à empêcher. Il nous avait raconté ça, la puissance de l’imagination face à une dictature, en prenant un petit déjeuner aux Saintes-Maries-de-la-mer, un jour d’été. Anne écoutait les combats de Ricardo, fils de réfugiés espagnols, ça l’avait impressionnée je crois, et on s’était fait la promesse d’aller voir ses pièces au festival d’Avignon.
midi est venue cette idée, d’une discussion avec Ricardo. Une idée simple, de lancer un appel à lire les textes d’Asli Erdoğan partout où on ne l’attendait pas. Dans les théâtres, les rues, les rencontres d’écrivains, les festivals, les Nuit Debout, les radios, les ateliers d’artistes, les librairies. Je fais confiance à Ricardo. Son théâtre est un lieu de parole, une scène où la parole peut s’inventer enfin libre, coléreuse, imprévue. Et puis il avait lutté contre la junte de Pinochet, au Chili, en utilisant la subversion d’un théâtre de rue impossible à empêcher. Il nous avait raconté ça, la puissance de l’imagination face à une dictature, en prenant un petit déjeuner aux Saintes-Maries-de-la-mer, un jour d’été. Anne écoutait les combats de Ricardo, fils de réfugiés espagnols, ça l’avait impressionnée je crois, et on s’était fait la promesse d’aller voir ses pièces au festival d’Avignon. 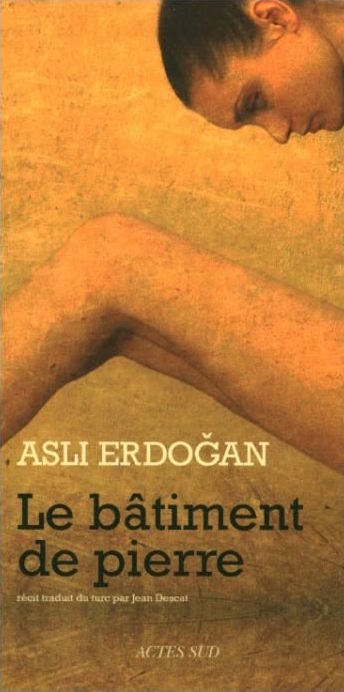 Elle a raison. Ce que le pouvoir turc reproche avant tout à Asli Erdoğan, c’est d’écrire la vérité, c’est-à-dire la dérive d’un gouvernement ivre de puissance, de plus en plus enfermé dans un déni paranoïaque de la réalité, qu’il s’agisse du génocide arménien ou de la culture kurde. La folie d’un tyran qui renoue avec l’impérialisme ottoman. On le sait depuis Soljenitsyne et Sakharov : la force d’une vérité humaine est ravageuse quand un écrivain s’en empare. Ailleurs, sous d’autres tropiques, Reinaldo Arenas et Carlos Liscano en ont donné la preuve. Face aux tyrans, la parole d’un écrivain indompté est ravageuse. D’où la violence. D’où la peur pour Asli qui m’empêche de dormir, depuis que les procureurs d’Istanbul ont requis la prison à vie, pour elle et Necmiye Alpay.
Elle a raison. Ce que le pouvoir turc reproche avant tout à Asli Erdoğan, c’est d’écrire la vérité, c’est-à-dire la dérive d’un gouvernement ivre de puissance, de plus en plus enfermé dans un déni paranoïaque de la réalité, qu’il s’agisse du génocide arménien ou de la culture kurde. La folie d’un tyran qui renoue avec l’impérialisme ottoman. On le sait depuis Soljenitsyne et Sakharov : la force d’une vérité humaine est ravageuse quand un écrivain s’en empare. Ailleurs, sous d’autres tropiques, Reinaldo Arenas et Carlos Liscano en ont donné la preuve. Face aux tyrans, la parole d’un écrivain indompté est ravageuse. D’où la violence. D’où la peur pour Asli qui m’empêche de dormir, depuis que les procureurs d’Istanbul ont requis la prison à vie, pour elle et Necmiye Alpay.