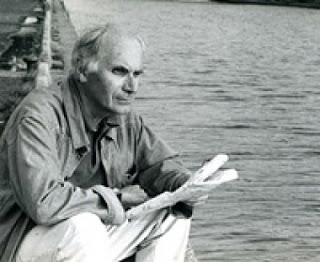À Gaëlle Fernandez Bravo

Rue Peretz Markish à Pollonoye, en Ukraine
Quelqu’un avait jeté l’anthologie de la poésie yiddish à la poubelle, à Sète. Je trouve ça nul. Qu’un abruti puisse condamner d’un seul geste «Le Miroir d’un peuple» – c’est l’autre titre que l’éditeur avait donné à cette anthologie de plus de 600 pages – à la poubelle et à la destruction par le feu, c’est monstrueux et banal à la fois. Mais quand même j’avais eu de la chance. J’avais trouvé le livre alors qu’il faisait nuit, une nuit sans lune et sans la moindre étoile. Je l’avais emporté avec moi malgré les salissures, et oublié sur ma table, dans la maison abandonnée. Plus tard, j’avais nettoyé la couverture du livre avec un peu d’eau tiède, puis je l’avais rangé dans une caisse à vin qui me sert d’étagère, juste à côté de ces poèmes qu’Uri Orlev avait écrits dans son enfance, enfermé derrière les barbelés de Bergen-Belsen. Un livre un peu sacré dans ma bibliothèque, et pour plusieurs raisons que je ne sais pas toutes expliquer. L’une des raisons, la plus ancienne, c’est que les poèmes aient été traduits par Sabine Huynh, qui est poète et vit sa vie de mère et d’écrivain à Tel Aviv, pendant qu’Uri Orlev écrit des livres pour les enfants à Jerusalem.

Portrait de Peretz Markish par Marc Chagall, 1923
J’ai pensé à cet exemplaire d’Anne Frank que Tibishane m’avait ramené d’une poubelle d’Arles. Ça m’avait mis en colère qu’on puisse jeter ce livre-là, précisément ce livre-là qu’avait écrit une enfant juive avant d’être arrachée à son enfance. Ce journal a toujours eu quelque chose de sacré à mes yeux. Le balancer aux ordures était un geste sacrilège et Tibishane, en l’extirpant des sacs de déchets, avait endossé le rôle d’un sauveur imprévu. Et Tibishane est d’abord ferrailleur : il fouille le soir dans les poubelles pour y trouver de l’or. Et s’il n’y a pas d’or au moins un peu de cuivre. Et s’il n’y a pas de cuivre au moins des livres qu’il me ramène comme un cadeau de tous les soirs.

Peretz Markish
Dans les poubelles des villes du sud, il y a des poèmes écrits par des Juifs, des romans écrits par des Russes encore en vie, des Antillais en exil ou des Arabes en colère, des autobiographies venues d’Inde et d’Afrique ou des chroniques écrites à Istanbul, le monde est devenu littérature jetée à la poubelle et la littérature coule dans mes veines. L’immense bibliothèque des répudiés du monde entier se trouve dans ces tas d’épluchures et d’emballages déchirés que les éboueurs emportent dans leurs camions jusqu’aux incinérateurs de déchets.

Peretz Markish lisant son appel, en 1941, au sein du Comité juif antifasciste
Hier matin, j’ai décidé d’ouvrir l’Anthologie de la poésie yiddish. Et de commencer à lire des poèmes, ceux de Peretz Markish que je ne connaissais pas. Parce qu’il y a des cigognes dans deux de ses poèmes, et j’ai pris ça pour un signal, une sorte de seuil par où j’allais pouvoir entrer dans les poèmes d’un inconnu.
Premier poème, un fragment de Chutes de neige :
Tempête aux milliers d’ailes
Agrippe en tes griffes mon ventre
— À l’altitude des cigognes
Dans l’éblouissement s’embrase ma tour blanche —
Ni l’argile, ni la brique,
Et ni les mains, ni les chaînes
— De blanches filles écumantes,
Des plumes extirpées des ventres
Et vers les bas s’agenouillent les hauts
— Je suis de nouveau
Je suis de nouveau !…
Tempête aux milliers d’haleines
Sur ma gorge un entrelacs blanc
— Tourbillonnez blancs incendies
Plus vite, vents, toujours plus vite
Cils de l’orage en rage, émiettez-moi,
Vent, allume les lunes blanches
— Versez par les bouches, versez par les outres,
Répandez par-devant, répandez par-derrière
Blanc soufflet et blanc forgeron,
Je suis de nouveau,
Je suis de nouveau !…

Peretz Markish
Choisis et traduits par Charles Dobzynski, qui est poète lui aussi, j’ai l’impression que chaque poème de Markish a gardé une grande part de sa puissance en français. C’est la magie des grands passeurs. Dans l’anthologie, il y a une vingtaine de poèmes de Markish, juste assez pour commencer à fasciner. Par exemple Les Amants du ghetto, qui commence par deux vers en coup de poing :
Frénésie pour le sang et le vin. La nuit tombe
Soudain sur le ghetto : C’est la nuit du bourreau —

Esther Markish, l’épouse de Peretz
Chaque poème a ses flammèches à l’intérieur des mots, petite lumière à partager. Et puis il y a des incendies, ils habitent eux aussi dans sa langue. Ne serait-ce que sa devise, que j’ai trouvée sur le site d’Esprits nomades. le site de Gil Pressnitzer : «Par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles.» Comment ne pas faire le lien avec la langue stellaire de Khlebnikov, celle qu’il cherchait dans les méandres de la Volga et jusqu’au Kazakhstan. Ils sont nés à dix ans d’intervalle. Khlebnikov en 1885 dans la steppe, pas très loin d’Astrakhan. Markish en 1895 à Pollonoye, une petite ville d’Ukraine où aujourd’hui, on peut trouver une rue Peretz Markish. Ils ont pu se connaître tous les deux. Ils étaient à Moscou à peu près aux mêmes dates. J’ai cherché dans les photos, si je tombais sur leurs visages côte à côte. Rien trouvé. Je chercherai encore.

Peretz Markish lors de l’enterrement de son ami, le comédien Solomon Mikhoels, en janvier 1948
En 1952, Markish a été tué d’une balle dans la nuque dans les caves de la Loubianka. C’est le portail de ce haut-lieu de la terreur que Piotr Pavlenski avait incendié, dans la nuit du dimanche 8 novembre 2015. Markish avait croupi trois années en prison, avant d’être condamné à mort et aujourd’hui, c’est Pavlenski qui est enfermé dans une cellule de Fleury-Mérogis, pour avoir mis le feu à un bâtiment de la Banque de France. Comme tous les poètes yiddish du Comité juif antifasciste, Markish était accusé de nationalisme juif dans un pays malade de la paranoïa du Kremlin. «Le groupe yiddish au sein de l’Union des écrivains était de proportion modeste, écrit Myriam Anissimov dans sa biographie de Vassili Grossman : quarante-cinq écrivains à Moscou, vingt-six à Kiev et six à Minsk. Cinquante-deux d’entre eux allaient payer de leur vie le fait d’être juifs, d’écrire dans une langue juive et d’avoir été membres du Comité juif antifasciste.»
Mais à mesure que je lis les poèmes de Markish, je sais que leur beauté aura plus d’importance à l’avenir que la pauvre folie de Staline. Sinon pourquoi est-ce qu’on écrit des poèmes ?
Je recopie encore un fragment de l’anthologie, pris à Tombée de la nuit.
Une cigogne de bois, le bec longiligne
Se tient, tube aspirant, au bord du puits du soir,
Sur un long pied décharné
Picorant, d’un chant craquetant
La lune toute nue, sur un plateau bleu…
Écorchés tout entiers les cieux,
Tailladés et troués
Par la douleur au loin de l’aboiement des chiens
Et par le pas des mots martèlement ténu
Mais les rues se divisent — leur tension se brise en silence
Et les maisons — par-dessus les toits aux yeux de nuées
Jouent timides, plus bas, plus bas.

Regard de Peretz Markish
Et enlisant Gil Pressnitzer, j’apprends que Markish a été l’ami de Chagall, et ça me fait plaisir d’imaginer ces deux-là discutant, à Paris, pendant que Chagall dessinait le très beau visage de Markish à trente ans. Les poèmes de Peretz ne forment pas encore ce continent d’Eurasie qu’ils deviendront plus tard, avec ses fleuves et ses mers intérieures, mais Markish écrit déjà beaucoup, des poèmes avant tout mais aussi un scénario, des romans et des articles. Un seul roman a été traduit en français, toujours par Dobzynski, mais il est aujourd’hui épuisé. Je vais continuer de chercher ses poèmes, les recopier à l’intérieur d’Un cahier rouge. Je crois qu’il y a des traductions en anglais, des textes aussi en russe, mais la plupart des grands poèmes des années trente ont été écrits en yiddish.
Il ne faut pas laisser Markish dans l’ombre que notre oubli dessine au fil des jours. Et empêcher qu’on puisse jeter ses poèmes à la poubelle. Comme un autodafé en douce. Qu’on fasse au moins une loi, en Europe, pour interdire que les poèmes yiddish des poètes assassinés par Staline puissent finir dans un incinérateur de déchets.
____________________
Anthologie de la poésie yiddish, Le Miroir d’un peuple. Présentation, choix et traduction de Charles Dobzynski, Poésie Gallimard, 2000.