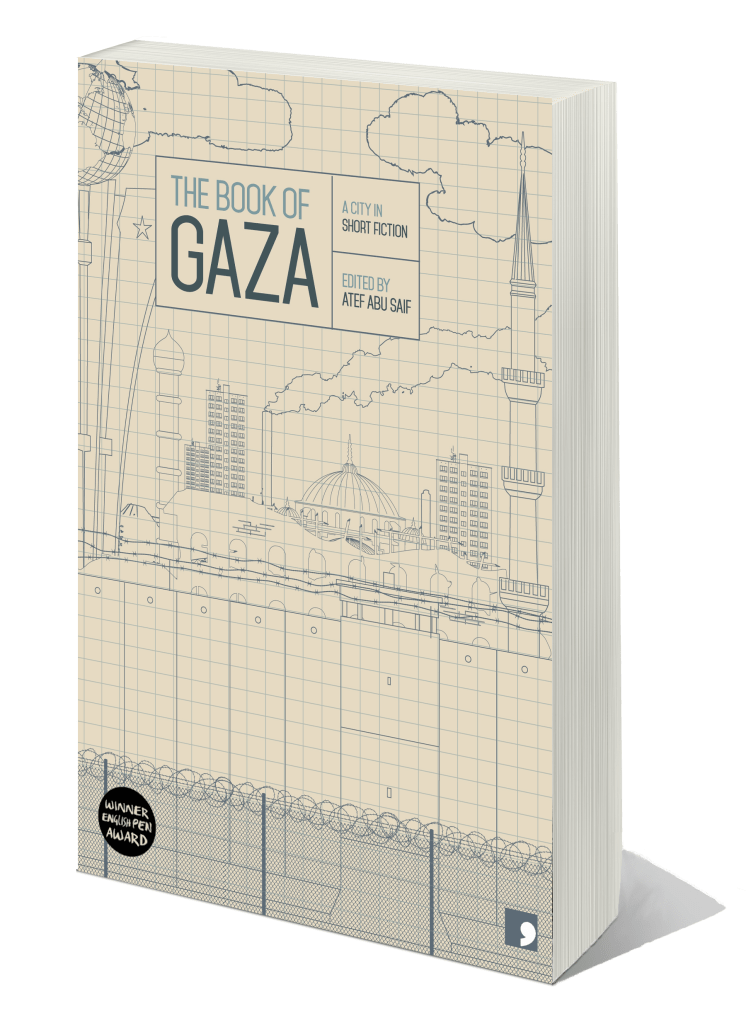★ « Je ne veux pas être un héros, je ne veux pas être un martyr, je ne veux pas être un faible, je ne veux pas être un simple d’esprit, je ne veux pas être un poète rêveur. Je ne veux pas accepter l’injustice. S’il me reste une minute à vivre, alors je veux être en paix avec ma conscience », écrivait le poète Khet Thi quelques jours après le putsch de la Tatmadaw, le 1er février 2021 en Birmanie.

Khet Thi n’est pas le seul poète à avoir été ciblé par la répression des militaires birmans. Arrêté avec sa femme, Chaw Su, il meurt sous la torture dans la nuit du 8 mai 2021. C’est l’auteur de ce vers qui servira de mot d’ordre sur les barricades qui se dressent à travers le pays : Auteur du vers « Ils tirent dans la tête, mais la révolution vient du cœur ». Le corps du poète a été rendu à son épouse avec un trou à la place du cœur.

K Za Win sera tué lui aussi pendant une manifestation. Dans un poème écrit en prison, il s’adressait à son père : «Peut-être que tu ne le sais pas encore mais / ton fils est en prison, tombé dans un guet-apens / pour avoir demandé à ceux qui osent s’appeler « police » / de ne pas nuire aux honnêtes gens.»

Photo Aung San Phyo.
Comme l’a écrit Wendy Law-Yone dans sa préface au livre Printemps birman. Poèmes et photographies témoins du coup d’État, «ce ne sont pas leurs idées ou leurs œuvres qui leur ont valu d’être traités comme des « menaces pour la sûreté publique ». S’ils ont subi la répression, c’est parce qu’ils comptaient parmi les fantassins des premières lignes de la révolte, parmi les manifestants qui sont descendus sans armes dans la rue, bravant les balles, tenant les barricades.»

D’autres poètes ont rejoint la Force de défense populaire, qui rassemble les insurgés ayant pris le maquis à l’abri de la jungle. Le recueil Printemps birman, publié aux éditions Héliotropismes, rassemble quatorze de ces écrivains-soldats qui n’ont pas hésité à affronter les soldats du nouveau régime.
« Ce printemps,/tandis que fleurissent les kapokiers rouges,/les chiens enragés s’agitent,/ grognent et montrent les crocs dans les rues,/ mordent tout ce qui bouge», a écrit Moe Nwe, tué à l’âge de 20 ans dans une ville de l’Etat Kachin, au nord de la Birmanie, le 25 mars 2021.
Certains des poèmes semblent avoir reçu la force de frappe des premiers surréalistes. Comme ces vers de Maung Day : « Pas de soleil dans le ciel, pas d’air dans nos poumons / La radio annonce que la paix a un cancer du poumon.»
Presque trois ans après le printemps birman, il semble que le camp des poètes et des émeutiers prenne le dessus sur la junte militaire. C’est un scénario qui fait chaud au cœur, et qui prend le contre-pied de ce qui s’était passé lors du printemps syrien, en 2011.

Depuis le coup d’État de février 2021 et les manifestations qui l’ont suivi, les guérillas contre la junte au pouvoir ont pris beaucoup d’ampleur. Depuis fin octobre 2023, une alliance entre groupes rebelles issus des minorités ethniques a mené une action commune contre la junte – l’opération 1027 – qui a permis de gagner du terrain et de capturer de nombreuses bases de l’armée birmane.

Le 12 novembre 2023, par exemple, des membres de la guérilla de l’ethnie Kokang se sont emparés de deux ponts et d’une base militaire stratégiques dans l’Etat shan, près de la frontière avec la Chine. C’est une victoire historique, accomplie sans aucune aide de la communauté internationale, alors que la junte vient d’annoncer la prolongation de l’état d’urgence et que nombre de lycéens et d’étudiants rejoignent les révolutionnaires anti-junte.

Thi à Pearl.
Dans les jours qui ont suivi le coup d’État, avant d’être abattu d’une balle dans la tête lors d’une manifestation, le poète K Za Win avait publié un poème intitulé Révolution, qui finissait sur ces vers : «L’aube viendra /C’est le devoir des audacieux /de conquérir l’ombre et de faire advenir la lumière.» C’est ce que les révolutionnaires anti-junte semblent sur le point de réaliser cet hiver. Ils conquièrent l’ombre en unissant les différents groupes armés de rebelles et feront advenir la lumière en renversant la junte militaire qui leur a volé le pouvoir en 2021.

★ À lire : La longue histoire des poètes et poétesses révolutionnaires au Myanmar
★ À écouter : Birmanie, deux ans après le coup d’État, la résistance au cœur de la forêt, France Culture, mars 2023.